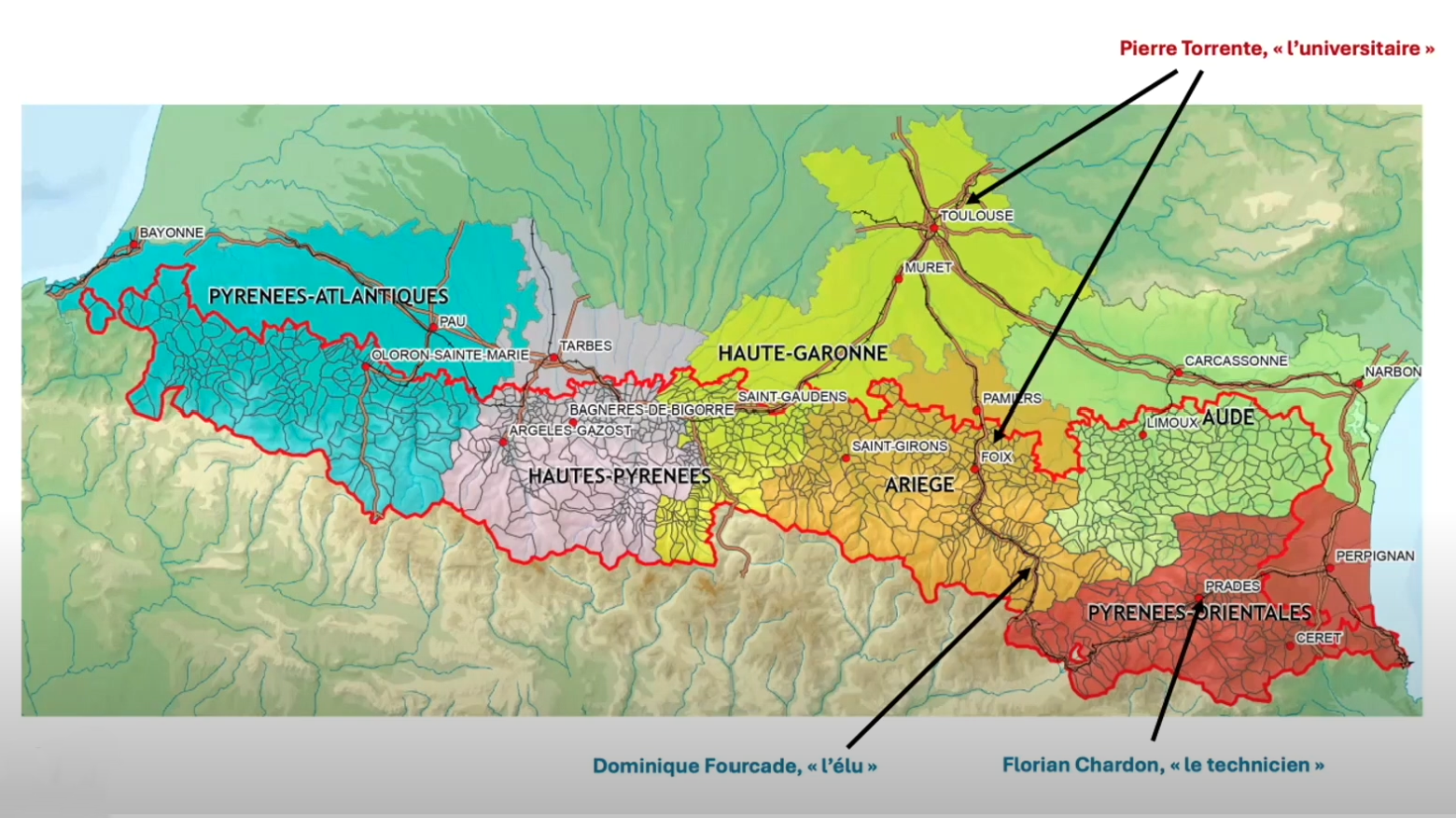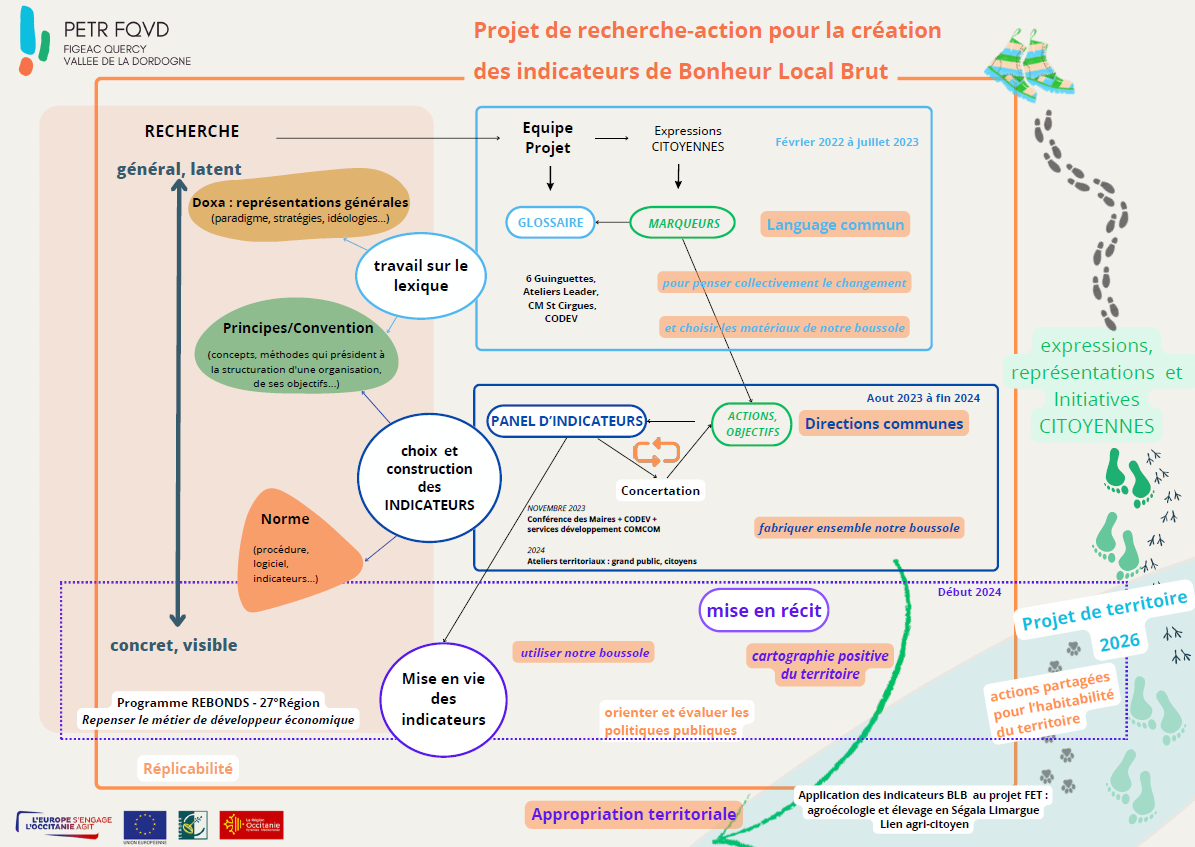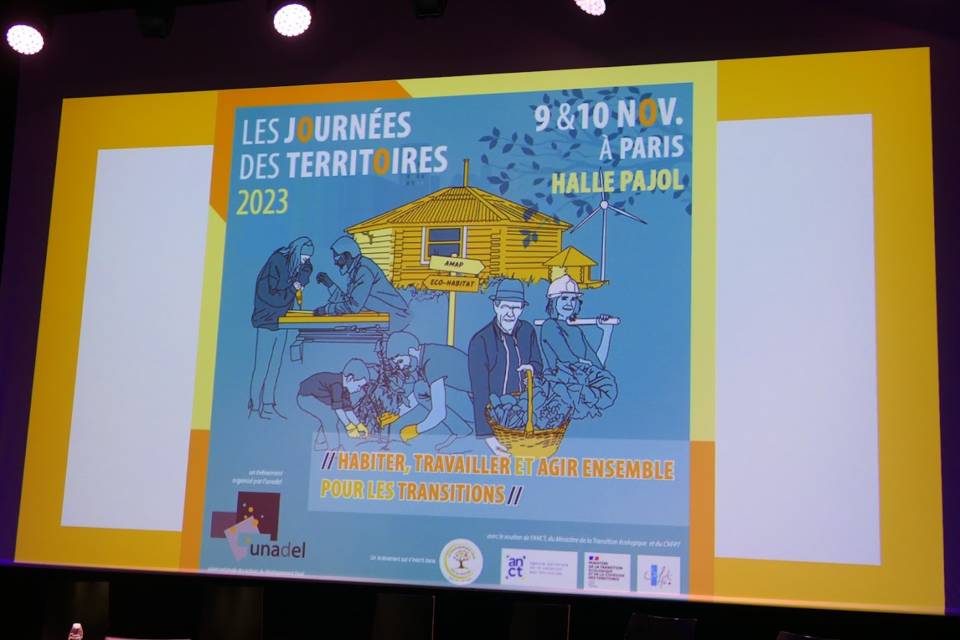Sous le soleil ligérien et dans un lieu magique, le Château de Goutelas, plus d’une centaine de personnes ont répondu le 8 septembre dernier à l’invitation de Cap Rural, autour des actions de développement rural à découvrir et redécouvrir et le regard de chercheurs… Un événement qui s’inscrivait dans la Rentrée du Développement Local