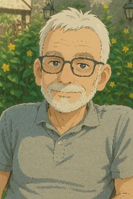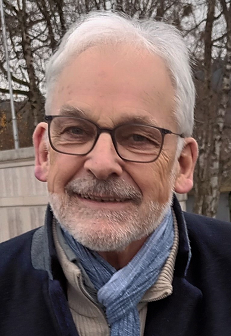union nationale des acteurs du développement local
150-154 rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris
Derniers articles
2025-07-07T16:51:39+01:00
L’Unadel recrute !
2025-07-10T06:56:27+01:00
la Revue de Presse
2025-06-19T20:36:36+01:00
Edito de Claude Grivel juin 2025
2025-06-11T21:22:17+01:00