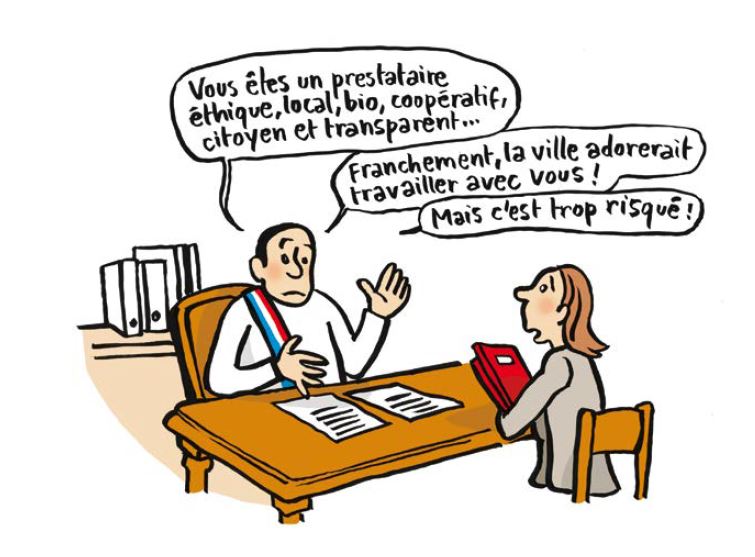Lire et télécharger le rapport de l’AITEC “Collectivités locales, reprendre la main, c’est possible !” “Le nouveau rapport de l’AITEC « Collectivités locales, reprendre la main, c’est possible ! Politiques publiques de transition démocratique et écologique : résistances et alternatives locales à la libéralisation » se fonde sur une enquête approfondie menée en 2017 auprès d’élu-e-s, d’agents territoriaux, et […]
« Quand tu cherches ton chemin, souviens-toi d’où tu viens » ! Ce proverbe africain souvent cité par Michel Dinet*, nous rappelle l’importance de l’enracinement dans une histoire et des valeurs pour donner sens à une trajectoire de vie ; la vie de celles et ceux qui individuellement ou collectivement partagent des engagements, des projets, des combats parfois, pour […]
Durant plusieurs mois, à la demande du Premier ministre Manuel Valls en juin 2015, Claudy Lebreton, Marjorie Jouen et Clara Boudehen se sont attelés à la tâche de réfléchir à la concrétisation d’une nouvelle politique d’aménagement et de développement durable des territoires de France dans une perspectives de renforcement de l’Union européenne. Pour réaliser ce travail, la mission […]
Le compte rendu du rapport au ministre délégué à la Ville, remis en juillet 2013 portant sur « Citoyenneté et pouvoir d’agir dans les quartiers populaires : pour une réforme radicale de la politique de la ville », de Marie-Hélène Bacqué et Mohamed Mechmache, sociologues, est disponible en ligne. Ce travail, mené en 2013, a réuni une commission composée de […]