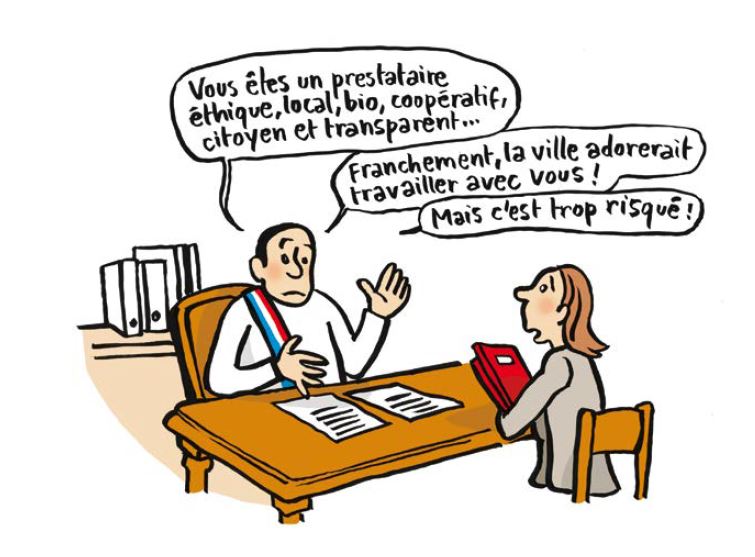Lire et télécharger le rapport de l’AITEC “Collectivités locales, reprendre la main, c’est possible !” “Le nouveau rapport de l’AITEC « Collectivités locales, reprendre la main, c’est possible ! Politiques publiques de transition démocratique et écologique : résistances et alternatives locales à la libéralisation » se fonde sur une enquête approfondie menée en 2017 auprès d’élu-e-s, d’agents territoriaux, et […]
Le lundi 6 mai, Georges Gontcharoff, les administrateurs et l’équipe de l’Unadel, tous celles et ceux qui ont contribué à la rédaction du livre “Vous avez dit développement local ?” publié par la librairie des Territoires, ont organisé une rencontre de présentation de l’ouvrage [disponible en cliquant ICI]. Celle-ci a permis d’échanger sur l’histoire et […]
Le maire de Kingersheim, Joseph SPIEGEL est un compagnon de route de l’Unadel. C’est aussi un passionné du fonctionnement démocratique et des expériences qui font sens. Il parle souvent de son expérience locale de la démocratie d’implication. Pour la 2ème année consécutive, il accueille dans sa commune les Rencontres de l’interrogation Démocratique. Jean Maillet, Axel […]
Par son ampleur, par sa tenue, la manifestation de ce dimanche 11 janvier 2015 a impressionné la France. Elle a aussi rassemblé et laissé son empreinte dans bon nombre de démocraties à travers le monde. Par sa mobilisation, par son unité, ce peuple français volontiers frondeur, gouailleur, a rappelé les fondamentaux issus des Lumières, […]