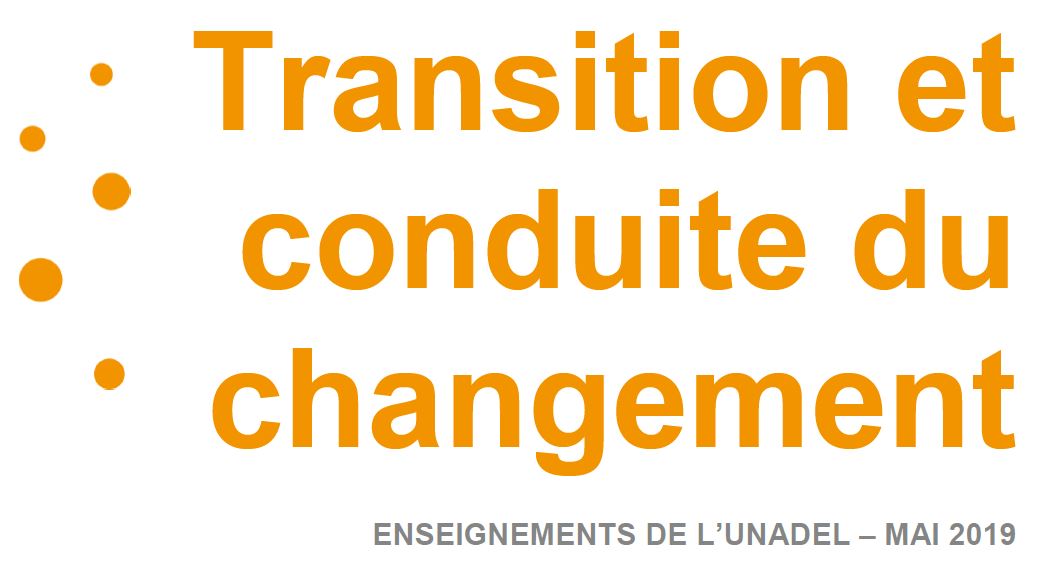Retour sur l’AG de l’Unadel et projet 2019 L’Assemblée générale de l’Unadel a eu lieu cette année le vendredi 17 mai, de 9h30 à 13h à la Fédération des centres sociaux. 32 personnes y ont participé (pour information, il est toujours possible d’adhérer à l’association et de prendre part à ses activités). L’ordre du jour […]
Ce rapport retrace les enseignements que l’Unadel a tirés de sa collaboration à l’étude ADEME de 2018-2019, en partenariat avec Quadrant conseil et JFC3D. L’Unadel y analyse les ressorts d’une transition énergétique de territoires à partir des exemples : de la ville de Malaunay (Normandie), de la Communauté de Communes du Val d’Ille-Aubigné (Bretagne), de […]
Le lundi 6 mai, Georges Gontcharoff, les administrateurs et l’équipe de l’Unadel, tous celles et ceux qui ont contribué à la rédaction du livre “Vous avez dit développement local ?” publié par la librairie des Territoires, ont organisé une rencontre de présentation de l’ouvrage [disponible en cliquant ICI]. Celle-ci a permis d’échanger sur l’histoire et […]
Le maire de Kingersheim, Joseph SPIEGEL est un compagnon de route de l’Unadel. C’est aussi un passionné du fonctionnement démocratique et des expériences qui font sens. Il parle souvent de son expérience locale de la démocratie d’implication. Pour la 2ème année consécutive, il accueille dans sa commune les Rencontres de l’interrogation Démocratique. Jean Maillet, Axel […]
Article paru dans la revue Transrural (n°474 de mai-juin 2019) Claude Grivel, président de l’Union nationale des acteurs du développement local, revient sur le bilan de la mise en place des contrats de ruralité1. “Le contenu des contrats dépend beaucoup de la capacité et de la volonté des hommes et des femmes de faire projet […]
Xavier Loppinet est directeur de la Communauté de Communes du Pays de Colombey-les-Belles et du Sud Toulois. Sylvain Adam, délégué national de l’Unadel, a pu le rencontrer à Colombey-les-Belles le 25 février 2019. Sylvain Adam, pour l’Unadel / mars 2019 Durant notre entretien, Xavier Loppinet revient sur l’histoire du développement local de ce territoire depuis […]
Rencontre Territoires à Vizille, Isère Agir ensemble pour développer de nouveaux projets pour le territoire La rencontre co-organisée avec le Conseil Local de Développement Alpes Sud Isère (CLD), le Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes Alpes Sud Isère (CDDRA) et Cap Rural, a réuni près de 70 participants le 15 mars à Vizille. [metaslider id=4189] Beaucoup de convergences […]
Mairie Conseils organise une journée intitulée: les PETR pour relancer le projet de territoire. Elle s’adresse aux élus qui s’interrogent sur l’évolution de leurs Pays en PETR, suite à l’opportunité introduite par la loi Matpam de janvier 2014 : les modalités juridiques, les finalités, le devenir du projet de territoire. Les Pôles d’équilibre territoriaux et ruraux […]