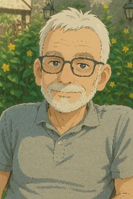Les valeurs sont-elles tombées de l’échelle ?
En ce début d’été, comment résister à la tentation de plonger la tête dans le sable pour ne plus voir, fermer le poste pour ne plus entendre et prendre des chemins de traverse pour s’échapper ?
La canicule, les feux, les inondations, les terrains de guerre qui se multiplient avec leurs abominations quotidiennes, le délire de dirigeants cyniques qui osent envisager des villes humanitaires, (nouvelle appellation des camps de relégation, de déportation et de concentration de populations survivantes et en sursis), la famine faucheuse de vie d’enfants innocents… Ce n’est ni admissible ni supportable !
Comme il n’est pas supportable non plus de continuer à empoisonner nos terres, nos agriculteurs, les femmes enceintes, les enfants, les personnes dites fragiles, avec des produits dont la toxicité n’est plus à démontrer.
Le cancer du rendement et des supers profits n’est plus une maladie : c’est une épidémie qui tue de plus en plus, en toute légalité !
Comment peut-on encore aujourd’hui prendre des décisions dont on sait qu’elles vont totalement à l’encontre du souhaitable et le justifier politiquement au nom d’intérêts économiques privés à préserver ?
L’échelle des valeurs est totalement inversée, à croire que la préservation de la vie, de la terre, du vivant comme le respect de l’autre dans son altérité et sa même humanité, sont frappés d’obsolescence programmée.
Il y a des décisions et des signes donnés qui sont totalement à contrecourant d’une prise de conscience de plus en plus massive des dérèglements de ce monde qui ne sont pas simplement climatiques.
Est-il encore temps de bifurquer ? Est-ce encore possible ?
J’aime bien le terme bifurquer pour au moins 2 raisons : il indique un chemin, une destination, la possibilité de choisir entre 2 directions. Celle qui conduit directement dans le mur avec des moyennes de températures de plus de 4 degrés avant 2050 ou celle qui anticipe, trouve des alternatives de contournement ou de réduction tout en allant vers plus de sobriété ; en un mot celle qui fait le choix d’un changement de destination sans pour autant revenir en arrière.
Dans le développement local comme dans toute trajectoire de vie, le chemin est au moins aussi important que le but, sinon plus. « Quand tu cherches ton chemin, souviens toi d’où tu viens ».
Bifurquer c’est chercher des alternatives à la compétition qui écrase pour développer des coopérations qui libèrent, qui permettent de retrouver du pouvoir de vivre et d’agir sans subir.
Né d’une volonté de se prendre en charge collectivement et de bifurquer comme le roseau se plie sous l’effet du vent avant de se redresser, le développement local est à la fois méthode et creuset de l’action
- dans les villes et villages qui ont subi la colonisation et le pillage des ressources naturelles, au siècle dernier notamment ;
- dans les ruralités qui ont dû faire face à l’émergence de l’agro-industrie, l’organisation des remembrements pour développer les surfaces cultivables avec pour effet de modifier les paysages et de voir partir les jeunes vers les zones urbaines tandis que les petites industries ont progressivement souffert de la globalisation puis de la mondialisation de l’économie.
La vie est devenue plus complexe, les parcours de vie plus sélectifs et la souffrance des quartiers sensibles privés de perspectives de travail et d’avenir est venue s’ajouter à celle des campagnes.
La question du territoire a évolué. Elle n’est plus seulement liée au lieu géographique où l’on vit mais à ce dont les populations dépendent comme le précisait si bien Bruno Latour.
Nous étions précédemment dans un monde de progrès social et d’émancipation et nous sommes passés dans un monde de profusion de biens inutiles et d’extrêmes dépendances. Or ce dont nous dépendons définit ce que nous sommes.
Ce dont nous dépendons définit ce que nous sommes
Dans une région ou un département en déprise, dans un quartier sensible de la politique de la ville, dans les ruralités les plus éloignées et à faible densité de population, les dépendances sont évidemment plus fortes et le besoin de politiques publiques réparatrices ou compensatoires – qui contribuent aussi à renforcer les dépendances – plus important.
Mais, est-il possible de s’en sortir autrement ? Est-il possible de passer d’une modernité qui broie en même temps les hommes, les paysages et le vivant, à une transformation de l’habitabilité de la terre tout en préservant l’abondance et la liberté, en réduisant les dépendances tout en contribuant à plus de justice sociale ?
En un mot comment écologiser ?
Comment le faire dans nos institutions, dans nos bassins de vie, dans nos pays en crise et en guerre ? Comment mieux habiter la terre alors que tout semble joué, perdu, fini, alors que finalement rien n’a vraiment commencé ? En se redonnant de la puissance d’agir individuellement et collectivement !
C’est un peu et en toute modestie, le rôle d’un réseau de développement local comme celui de l’Unadel que d’y aider à sa façon avec ses petits moyens.
Depuis 33 ans l’Unadel rassemble et met en réseau les personnes, les collectivités et les organisations, des élus, des associations, des formateurs, des acteurs et actrices de la culture, de l’économie, des services, toutes celles et ceux qui, dans les quartiers, communes, pays, intercommunalités, œuvrent à la construction d’un développement local autour d’un projet partagé. Et le projet doit être écologique ou il ne sera pas, n’en déplaise à tous ceux qui considèrent les écologistes comme des prédateurs à abattre.
Le projet c’est le chemin, pas la destination
Pour bien comprendre ce que vivent les gens dans les territoires nous devons aller à leur écoute. Et nous le faisons de plus en plus en cherchant à repérer comment les acteurs locaux s’organisent, comment les impacts des dérèglements climatiques et des hausses de température sont appréhendés, comment on se parle dans les bassins de vie, comment on fait ensemble ou non ? Comment on facilite l’engagement individuel ou collectif, on croise les regards, on développe des solutions ? Comment on accompagne la formidable capacité des personnes à inventer des solutions, à s’adapter, sans toujours le faire savoir ? Comment les circuits courts, les expériences d’insertion par l’économique, les questions d’alimentation ou de santé, sont-ils des leviers de transformation sociétale et des voies qui permettent de toucher à l’essentiel de ce qui fait lien et territoire commun ?
Tout cela se documente, se partage, contribue au changement de paradigme et ce n’est pas possible sans animation. C’est tout le sens de l’ingénierie dont les territoires ont besoin dans la durée, pas d’une ingénierie trop technique et spécialisée qui est utile mais pas suffisante ! Plutôt d’une ingénierie « couteau suisse » qui touche à toutes les disciplines et qui prend le temps d’écouter, de comprendre, d’accompagner et d’aider à la coconstruction des convergences qui permettront de faire projet et territoire de résilience en commun, malgré les différences et les postures contradictoires.
Ce n’est pas possible sans aiguillon, c’est-à-dire sans portage politique, sans leadership facilitateur et rassembleur qui n’impose pas une destination mais partage sa vision.
A l’heure du dérèglement du monde et du climat, il nous faut redonner sens et vie au développement local, à ses principes et ses fondements. L’actualité du développement local, c’est la construction des coopérations entre celles et ceux qui font bouger leur territoire et réenchantent l’engagement, le débat, la controverse et la résolution non violente du conflit, en remettant humains et non humains au centre de l’intérêt général et le pas de côté qui permet de sortir des postures et des suffisances pour bifurquer ensemble vers plus de sobriété, d’humilité, de temps et d’espaces partagés.
Pour redresser l’échelle et repositionner les valeurs du développement local en bonne place, l’Unadel apportera sa part dans les mois à venir à la mise en place d’Etats généraux communaux, car les solutions ne viendront pas d’en haut mais bien du local et de la proximité, de ce qui relie et non de ce qui sépare. Cela passe aussi par une reconnaissance des associations et de leur fonction dans la commune, les territoires et le pays. Elles ne doivent pas être la variable d’ajustement de remboursement d’une dette dont elles ne portent aucune responsabilité.