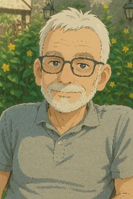Quelle vision pouvons-nous encore partager du monde ?
En 1984, le groupe de rock Téléphone rêvait « d’un autre monde où la vie serait féconde […] et d’une autre terre qui resterait un mystère […] Dansent les ombres du monde…dansent… »
En ce début de printemps 2025, les ombres du monde sont effrayantes.
Le monde peut-il encore faire rêver ? Et peut-on encore rêver de le changer ?
L’éternel adolescent que je suis resté, veut encore y croire, même si la cause apparaît bien désespérée.
Le rêve est un moteur. Le Pacte social et républicain un contrat et un bien commun. Il est de plus en plus malmené cependant.
Le dossier publié ce mercredi 16 avril par le journal Libération s’ouvre sur l’importance de l’heure locale. « Face au pessimisme ambiant, les territoires se retrouvent en première ligne pour entretenir le lien social ». C’est bien aussi notre conviction et ce qui motive notre engagement au quotidien, que nous soyons élus locaux, agents des services publics ou acteurs associatifs.
Plus que jamais le développement local doit permettre à chacun de prendre sa part dans le tissage des liens qui nous permettent de faire société sans transformer nos territoires locaux et nationaux en champ de bataille.
Ce n’est pas simple quand l’État est de moins en moins planificateur et protecteur et de plus en plus au service du marché. Les choix budgétaires d’hier et ceux annoncés pour demain ne rompent pas avec cette orientation prise depuis plusieurs décennies. Comme le dit Anne-Laure Delatte, chercheuse au CNRS, qui constate que les déboires d’une politique budgétaire creusent la défiance entre les citoyens et l’Etat, le même euro investi dans les services publics n’a pas le même impact carbone que celui qui est accordé aux sociétés fortement émettrices de pollutions. Or la grande masse des aides publiques, fiscales et sociales, va à ces grandes sociétés plutôt qu’au soutien aux collectivités locales ou aux associations.
Il y a pour l’État une marge de progression pour redonner confiance aux citoyens et des budgets pour agir, qui soient moins dépendants d’un pouvoir centralisé et soumis à la pression des grandes entreprises et du marché.
Pour penser le monde, le panser aussi sans doute, il faut une part de rêve et surtout du pouvoir d’agir, de débattre et de participer à la prise de décision publique en toute humilité comme nous y invite Claire Thoury, présidente du Mouvement Associatif et membre du Conseil Economique Social et Environnemental. Comme elle le souligne, le tissu associatif est exceptionnel et fait la cohésion sociale de notre pays avec ses 20 millions de bénévoles, les 1,4 million de salariés et 70 000 associations qui se créent chaque année.
Les associations peuvent aider à retrouver la confiance dans ce pays et ses dirigeants si on n’en fait pas la variable d’ajustement des budgets nationaux et locaux soumis à l’épreuve de la dette, largement construite sur l’aide aux grandes sociétés capitalistiques.
L’égalité femme / homme : une responsabilité collective
Il y a un mois j’évoquais dans cette lettre mensuelle la parité en politique. Elle sera enfin d’actualité dans tous les conseils municipaux en 2026 mais reste à conquérir dans l’intercommunalité. Cela ne se fera pas sans scrutin direct sur liste transcommunale.
Selon Oxfam, il faudra 300 ans pour atteindre l’égalité homme/femme dans tous les domaines. Les groupes femmes des années 70 en ont rêvé. Les organisations syndicales continuent à se battre dans les entreprises pour cette cause ô combien légitime et juste. Et pourtant…les progrès sont si lents.
Dans le monde, une femme est tuée toutes les 10 mn par son partenaire ou par un membre de sa famille. Nous avons tous rêvé d’un monde où la femme n’est pas seulement l’avenir de l’homme mais aussi son égale. Nous rêvons d’un monde où les femmes ne seront plus les victimes de discriminations salariales et de violences infra familiales.
Nous portons une responsabilité collective et ne pouvons nous résoudre à ne jamais connaître ce monde plus égalitaire, plus respectueux, plus porteur de positivité et de sororité. Le monde vu par les femmes doit nous aider à le changer avec elles.
Les territoires au prisme de la jeunesse et des ruralités
L’Institut des Hautes études des Mondes ruraux[1] (IHERMu) a été créé et installé il y a quelques jours. C’est une initiative du Parlement rural auquel l’Unadel participe, qui a obtenu de nombreux soutiens. Dominique Faure, ancienne ministre en charge a accepté d’en prendre la présidence tandis que Patrice Joly, sénateur de la Nièvre et co-inspirateur de l’Agenda Rural assure la présidence du conseil scientifique.
Et dans le même temps les Écoutes Territoriales de l’Unadel se poursuivent dans plusieurs territoires. Elles alimentent nos réflexions et particulièrement celles de l’atelier coopératif « récits de vie et expériences de territoires ». Cette lettre comme les réunions miroir et les prochaines Journées nationales des Territoires se feront l’écho de ces travaux qui mobilisent des équipes écoutantes composées de 4 à 7 personnes selon les lieux et les moyens mobilisables (experts, chercheurs, salariés de nos réseaux et bénévoles formés à la méthode des Écoutes) . Le réseau régional TCO prend sa part dans les écoutes 2025 sur le thème transition territoriale et démocratie, tout comme Citoyens & Territoires Grand-Est sur les rapports communes-intercommunalités.
Nous espérons, avec le concours de l’ANCT et de la Fondation de France, pouvoir capitaliser tous ces travaux à l’automne prochain et produire un document de synthèse. La parole des jeunes et leur vision rafraichissante de la ruralité auront cette année toute leur place grâce au concours et à la vision des étudiants en master en alternance de l’Université de Grenoble-Alpes qui ont participé à une écoute expérimentale sur l’ouest vosgien, ainsi que des étudiants en BTS de la maison familiale rurale de Gugnécourt (88) auditionnés récemment dans le cadre de l’Écoute labo de la ruralité.
La jeunesse n’est pas décidée à subir mais bien à agir pour une ruralité accueillante, conviviale et festive, dans des territoires reliés et interagissant avec les villes où elle pourra trouver emploi, relation, culture et services.
A suivre …
Face à la complexité du monde, la tentation du couperet de la simplification simplificatrice
Les fausses bonnes idées ressurgissent régulièrement avec le sentiment de bien faire puisque c’est populaire. Heureusement l’Assemblée Nationale n’a pas suivi le zèle de la commission qui proposait de couper la tête à toutes les agences et autres instances qui donnent du poil à gratter à ceux qui laissent à penser que la vie en société et la démocratie peuvent s’affranchir de règles, de conseils, de réflexions tierces, de contre-pouvoirs enfin. Est-ce une manière de nous préparer à un changement radical de gouvernance ? Bien sûr il est possible, souhaitable parfois, d’améliorer le fonctionnement et l’efficience de ces organismes, le plus souvent consultatifs comme les Conseils Economiques, Sociaux et Environnementaux, les conseils de développement ou prescriptifs et/ou en charge de la mise en place des politiques publiques, notamment dans le domaine de l’environnement ou de la consultation publique sur les grands projets.
Mais si l’on veut panser ensemble les maux de notre société et de notre démocratie, il est urgent de ne pas empêcher de penser et d’autoriser le bon déroulement du débat public et de la prise de décision publique, dans le cadre de procédures et de processus indépendants et contradictoires, qui ne gomment pas ce qui fait controverse.
La simplification n’est possible que si elle n’est pas simpliste. Le vote avec une faible majorité a permis à l’Assemblée Nationale d’éloigner le couperet. Elle doit rester vigilante avec le soutien de la société civile qui a su réagir avec une belle unanimité.
[1] Pour devenir auditeur de l’IHERMu, aucun prérequis n’est exigé pour les professionnels ayant 5 années d’expérience. Renseignements et modalités d’inscription via le formulaire en ligne (www.ihemru.fr avant le 15 juin 2025). La certification Qualiopi autorise les divers dispositifs de financements OPCO ou publics de la formation.