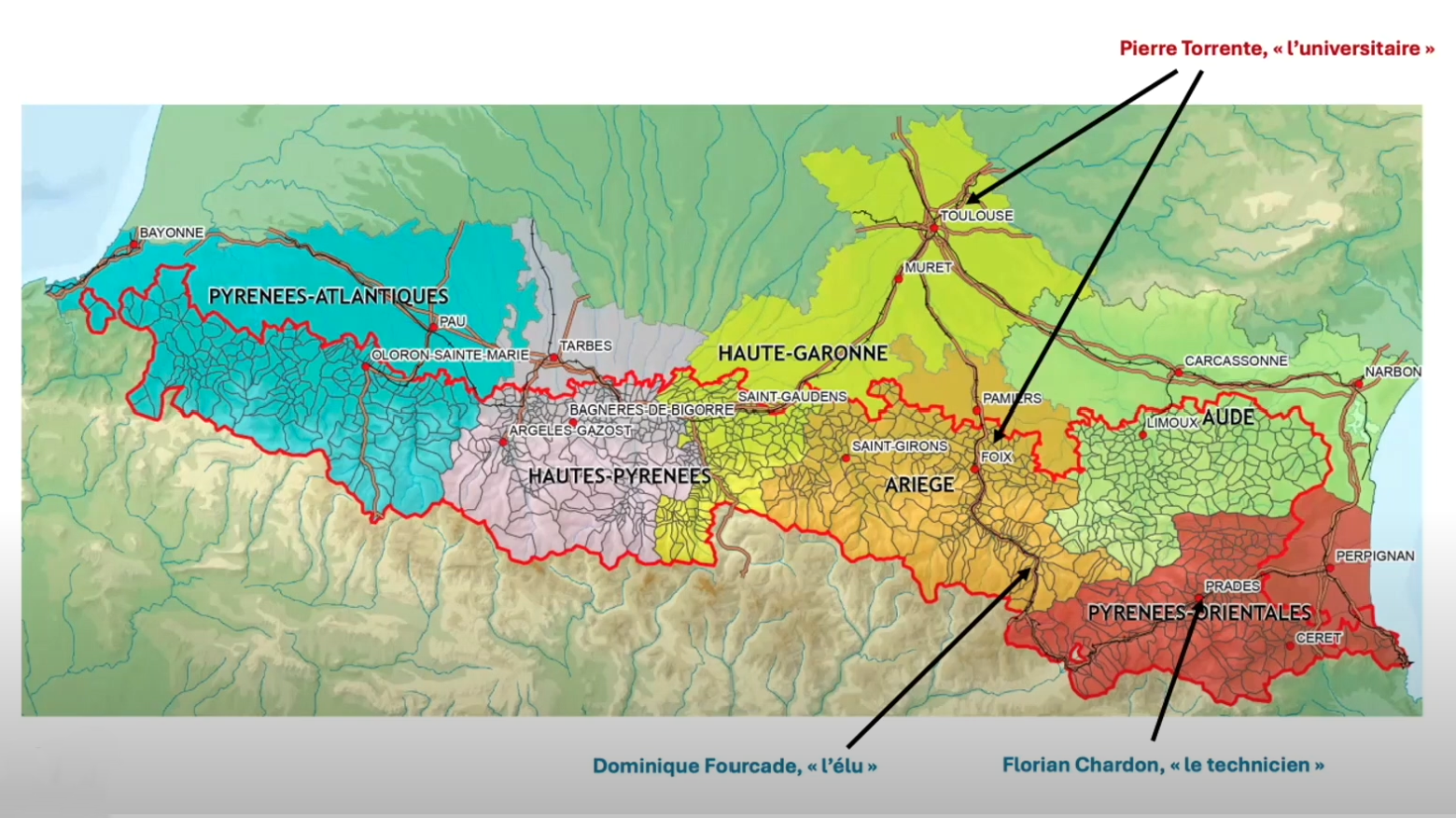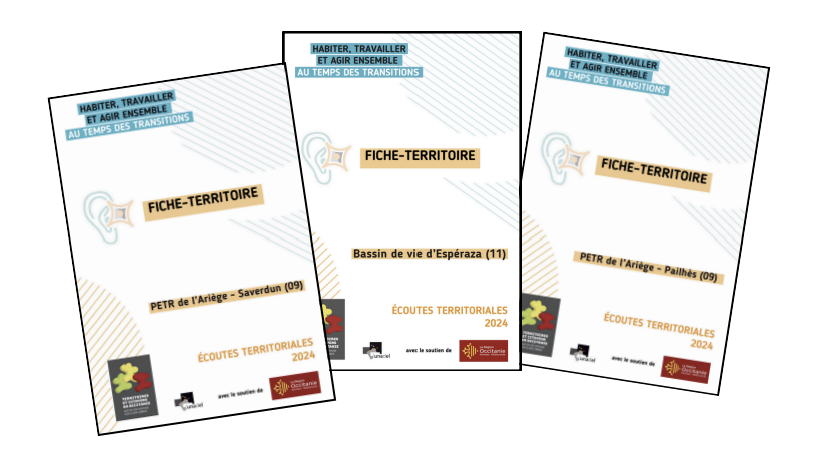Que retenir du rapport sur les écoutes territoriales 2023 de l’Unadel ? Par Alix ROCHE, vice-présidente de l’unadel. Les territoires sont face à l’urgence de transformer les modes d’habiter de travailler et d’agir ensemble au temps des transitions. Nous n’avons pas le choix !
Loi d’Orientation des Mobilités (LOM)– Episode 1 : un rendez-vous manqué pour la transition écologique et le développement local ? Contribution de Stéphane Loukianoff – adhérent de l’Unadel Alors qu’un couvre-feu national est en vigueur depuis des mois, alors que nos déplacements journaliers sont désormais contenus dans un rayon de 10 km autour de notre domicile, qui […]
31 mars – 3èmes Rencontres annuelles :Vers une nouvelle économie territoriale !Territorialisation, coopération et dynamiques de transition. La période actuelle révèle la créativité des territoires et les ressources sur lesquels ils peuvent s’appuyer pour répondre aux défis de notre temps. Elle met aussi en exergue de façon vive et parfois crue la fragilité économique des […]
Texte retranscrit tel que proposé par Clémence Dupuis à la deuxième session du Parlement Rural Français le 8/10/2020, suivant une formule de questions au gouvernement, en présence de secrétaire d’État chargé de la ruralité, Joël Giraud. Bonjour, J’ai été élégamment invitée à relayer au Parlement Rural Français un propos partagé avec Jean Louis Coutarel lors d’un […]
La Traverse a réalisé pendant 6 mois un Tour de France des territoires ruraux pour y observer les dynamiques à l’œuvre en matière de transition écologique et sociale. L’association en a tiré une série radio dans laquelle chaque podcast présente un territoire traversé. Dans une perspective de résilience, le choix des territoires ruraux était lié […]
Préparons et démontrons la force de frappe des territoires pour sauver l’économie et la planète! “ De multiples tribunes formalisant jour après jour une attente de transformation du monde de l’après-Covid19. Seront-elles entendues ? Le moment est historique ! L’Union nationale des acteurs du développement local ( UNADEL ) sous l’égide de La Fabrique des […]
"C’est aux forces vives de chaque territoire que doit revenir l’initiative de lancer sa propre fabrique, de manière autonome, en fonction de ses spécificités (...)"