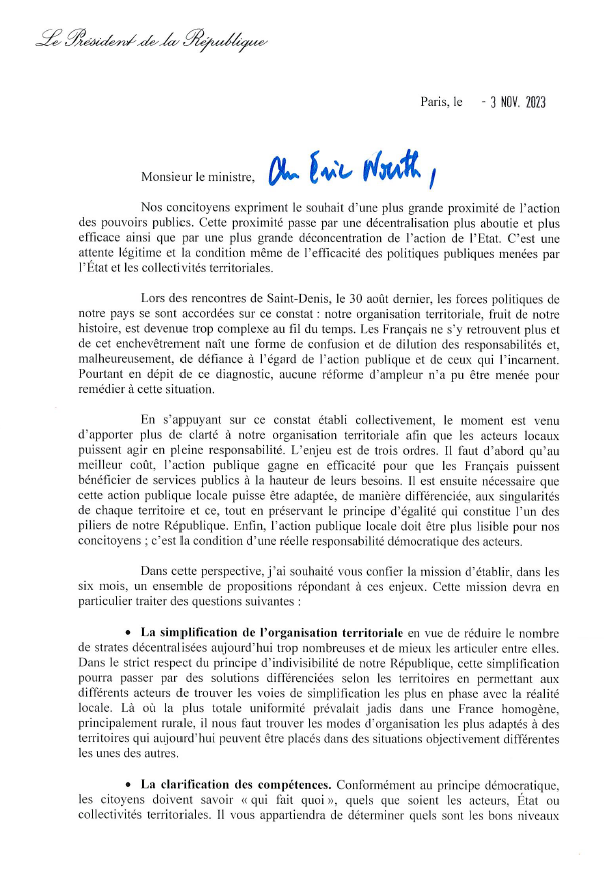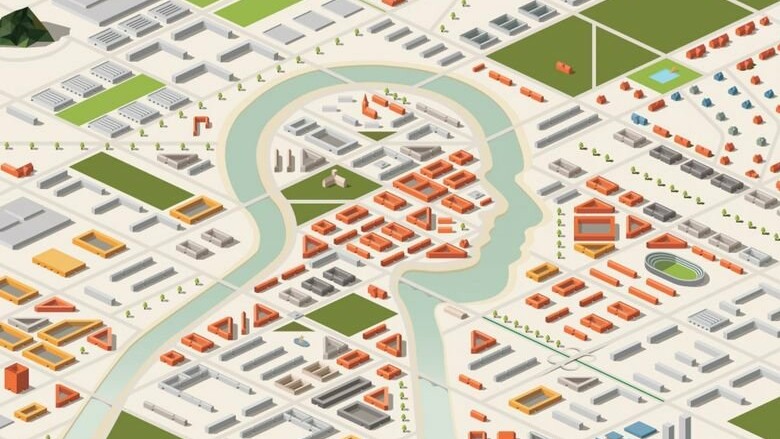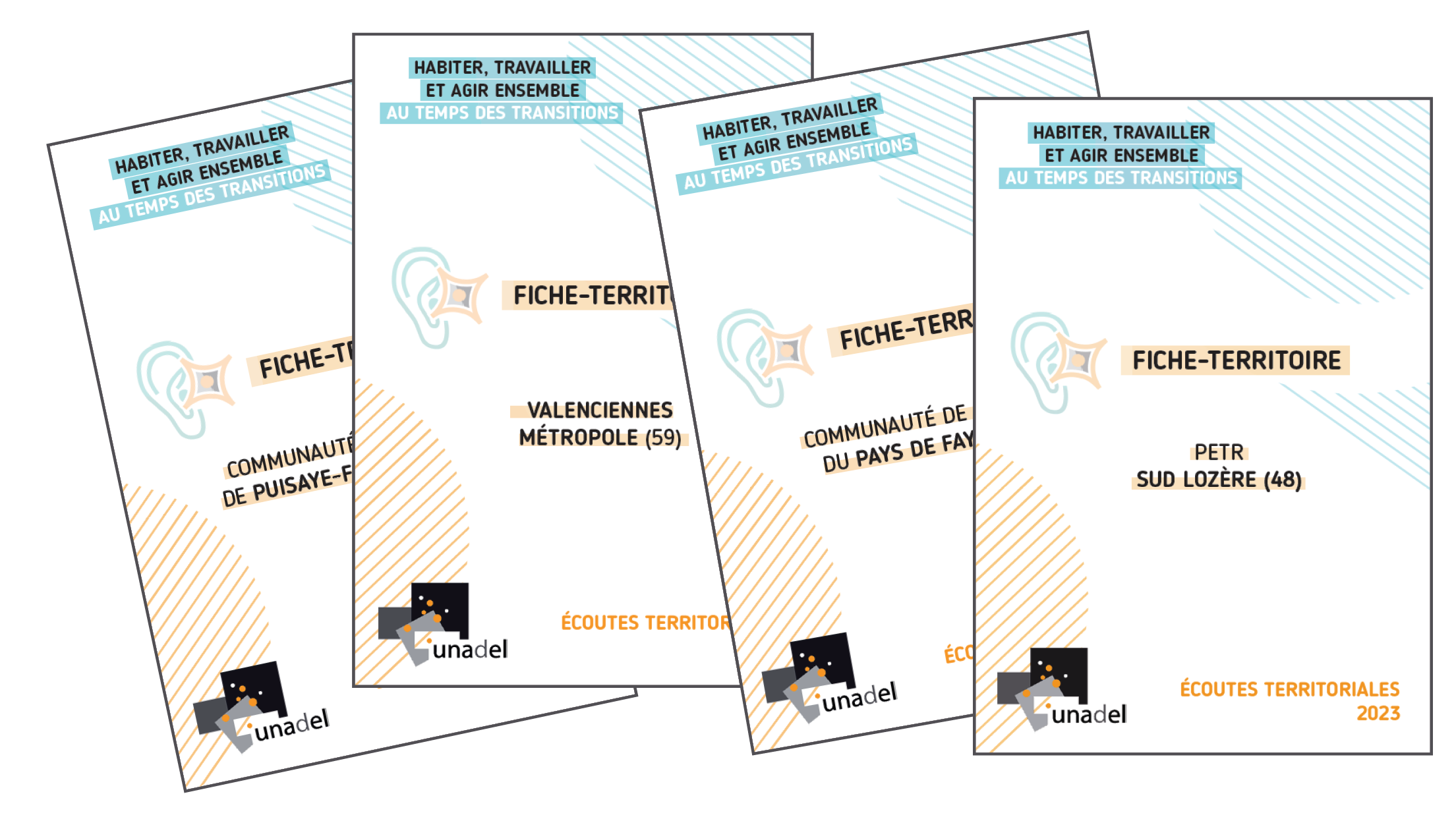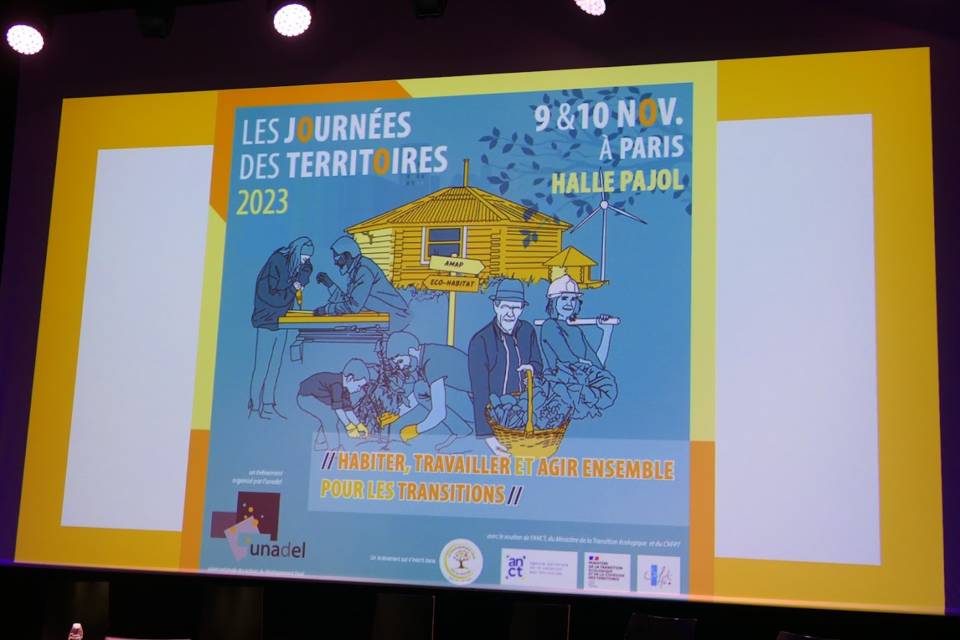Que retenir du rapport sur les écoutes territoriales 2023 de l’Unadel ? Par Alix ROCHE, vice-présidente de l’unadel. Les territoires sont face à l’urgence de transformer les modes d’habiter de travailler et d’agir ensemble au temps des transitions. Nous n’avons pas le choix !
Qu’ont les habitants de ces lieux à dire et à se dire ? Par Pierre-Antoine Landel, Administrateur de l’UNADEL, Géographe, ex Président du SCOT du Grand Rovaltain de 2010 à 2014, et Alain Villard, Conseiller Municipal de Romans, ex Directeur d’organismes HLM, ex chef de projet « politique de la ville ».